Dans cette conférence, Robert Neuburger explore les tensions entre humanisme et constructivisme dans les pratiques psychothérapeutiques. À travers une réflexion critique, il interroge les notions de vérité, de récit et d’éthique dans l’accompagnement thérapeutique, tout en soulignant les limites et paradoxes d’un monde où chacun construit sa propre réalité.
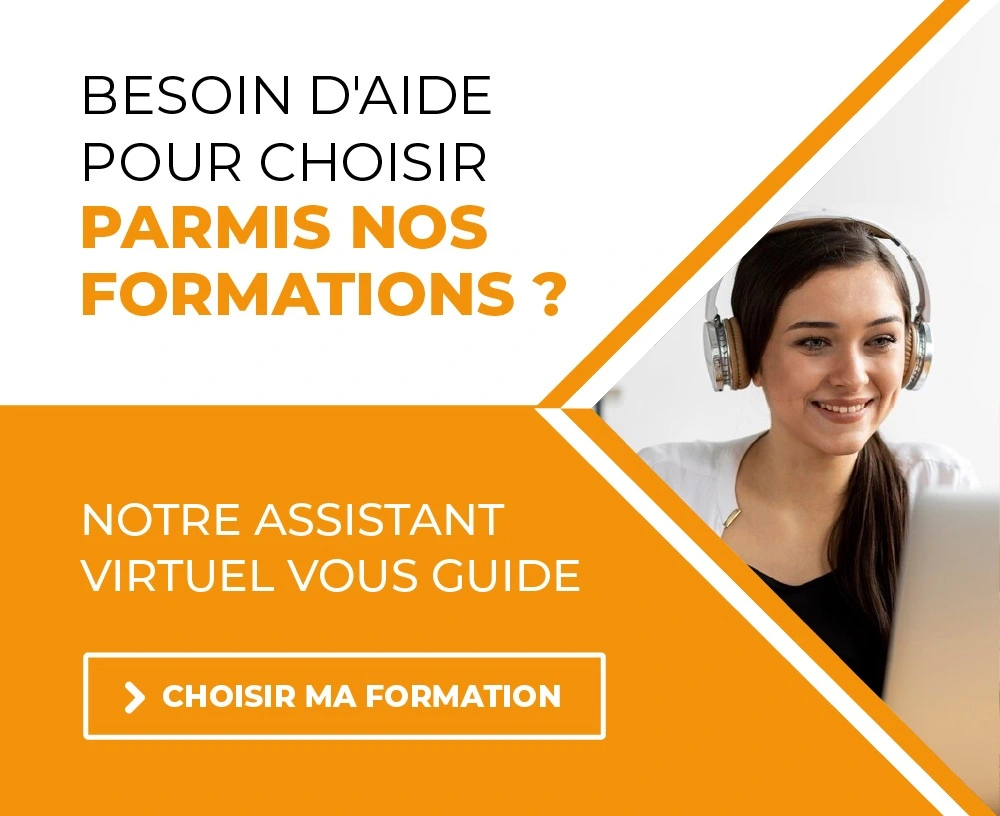

« Je ne sais pas si je vais être à la hauteur de cette présentation, » commence Robert Neuburger avec une pointe d’humour et de modestie. Le thème qu’il s’apprête à traiter, dit-il, l’impressionne lui-même : Humanisme et constructivisme. Une articulation difficile, mais essentielle.
Humanisme : relier les humains
Pour Robert Neuburger, l’humanisme renvoie à « tout ce qui relie les humains ». Il s’appuie sur la Déclaration universelle des droits de l’homme comme référence d’un idéal de fraternité. Sa carrière illustre cette volonté de relier : il a été thérapeute d’enfants, psychanalyste, systémicien, constructiviste, sans jamais renier ses expériences antérieures. Toutes ces approches cherchent à relier l’homme à lui-même, et les humains entre eux.
Il remercie chaleureusement Grégoire Vitry d’avoir donné l’occasion de rappeler ces valeurs à une époque où « le monde est de plus en plus fracturé ».
De la psychanalyse à la systémie : un parcours irrévérencieux
Sa carrière débute dans les années 60, alors que « la psychanalyse était la religion d’État ». À 14 ans déjà, il lit L’interprétation des rêves de Freud, fasciné par l’idée que le symptôme a un sens. « Rien ne vient de rien », conclut-il très tôt. Même ce qui semble insensé a une signification à découvrir.
Il raconte une expérience marquante : pendant 30 ans, il a dirigé une unité pour patients très psychotiques. Avec un collègue, ils ont mis en place une approche novatrice fondée sur un vide thérapeutique. Les soignants n’avaient pas le droit de proposer, prescrire ou interpréter. Ils étaient simplement présents avec les patients, dans une pièce commune, comme une salle d’attente. Cette posture de retrait visait à laisser émerger une demande, une initiative de la part des patients.
Cette expérience les confronte à l’incompréhension des familles. Certains s’inquiètent : « Il a voulu choisir son programme télé hier soir ! » ou « Ma fille veut venir seule au centre ! » Ces réactions révèlent la difficulté à tolérer le moindre changement dans l’équilibre établi.
La découverte de la thérapie familiale
Dans les années 70, la psychanalyse ne fonctionne pas avec les familles, et l’antipsychiatrie non plus. Par hasard, Neuburger rencontre Ziggy Hirsch, thérapeute belge centenaire encore en activité. Celui-ci lui parle de thérapie familiale. Une révélation. Avec lui, Neuburger fonde le premier groupe de formation à la thérapie familiale d’orientation systémique en France.
Il écrit L’Autre demande, un ouvrage central, dans lequel il propose un modèle pour choisir entre thérapie individuelle, psychanalytique ou familiale. Il distingue trois éléments dans une demande : l’allégation (ce qu’on invoque pour consulter), le symptôme, et la souffrance. Dans une famille, ces éléments sont répartis entre plusieurs personnes, ce qui rend l’approche systémique plus adaptée.
Humanisme, psychanalyse et systémie : des approches complémentaires
Robert Neuburger souligne que la psychanalyse et la systémie sont deux démarches humanistes. La première considère que le symptôme a un sens ; la seconde qu’il a une fonction dans un contexte. Deux lectures complémentaires de la souffrance.
Il cite le DSM-IV, la « Bible de la psychiatrie », dans sa version d’avant la dérive biomédicale : « Il n’y a pas de preuve que chaque catégorie de trouble mental soit une entité autonome… ». Le DSM reconnaissait alors une continuité entre normal et pathologique, dans une perspective humaine.

Réservez une consultation en cabinet à Paris Montorgueuil ou à distance en visio-conférence
Nous recevons nos patients du lundi au vendredi.
Pour prendre un rdv vous pouvez nous appeler au +33 (0) 1 48 07 40 40
ou au +33 (0) 6 03 24 81 65 ou bien encore le fixer directement en ligne
en cliquant ici :
La dérive « trumpiste » de la psychiatrie
Depuis, dit-il avec ironie, une approche qu’il qualifie de trumpiste s’est imposée. Elle classe, isole, fige les personnes dans des catégories diagnostiques rigides. Cette psychiatrie, selon lui, déshumanise et repose sur des bases peu scientifiques. Il cite le généticien Arnold Munnich : « Il n’y aura pas un gène de l’autisme, de la violence ou de l’homosexualité ».
D’où l’importance de congrès comme celui-ci, qui rappellent que « la souffrance, pas le symptôme, doit être au cœur de l’approche ».
L’apport du constructivisme radical
Robert Neuburger passe ensuite au constructivisme, en particulier au constructivisme radical de Heinz von Foerster. Il rappelle l’anecdote d’Anatole France, dans laquelle deux miroirs – l’un plat, l’autre convexe – s’accusent mutuellement de déformer la réalité. Un beau résumé du constructivisme, qui postule que toute perception est construite.
Ce courant a influencé les outils thérapeutiques. Il permet de développer des interventions non prédictives : on « chauffe » un endroit du système, sans savoir ce qui va émerger. L’important est de stimuler la créativité du couple ou de la famille.
Le symptôme comme verrou et opportunité
Il partage le cas d’un couple en panne, que reliait justement leur force de caractère respective. C’est cette même qualité qui bloque leur capacité de compromis. En nommant cette tension, il provoque une émotion forte chez eux. Il s’agit ici de « renarcissiser » le couple, leur redonner confiance en leur dynamique propre.
Autopoïèse, mythes et rituels : sources de créativité
Enfin, il introduit la notion d’autopoïèse, inspirée de Varela et Maturana. Un système vivant s’auto-organise, produit et maintient sa structure. Chez les couples et les familles, ce qui permet cette autopoïèse, ce sont les mythes et les rituels. Ces éléments nourrissent la créativité et la résilience.
Quand les couples sont en crise, c’est souvent parce que leur mythe fondateur a été atteint, ou que leurs rituels ne sont plus respectés.
Conclusion : pour une clinique du lien
La conférence se conclut sur un appel à repenser la clinique comme un lieu de lien, plutôt que comme un simple espace de production de récits. Le thérapeute, dit Robert Neuburger, n’est pas un ingénieur du sens, mais un artisan du lien, un médiateur entre des mondes singuliers.
Face à la prolifération des récits individuels, la tâche de la psychothérapie contemporaine est immense : maintenir un espace de dialogue, de confrontation féconde, où le récit ne devient pas une prison narcissique, mais une ouverture à l’autre.
Ainsi, loin de s’opposer, l’humanisme et le constructivisme peuvent se nourrir mutuellement. Le premier donne une boussole éthique ; le second, une carte des possibles. Ensemble, ils fondent une clinique vivante, incarnée, et profondément humaine.
Où se former à l’approche systémique et stratégique?
LACT propose plusieurs parcours de formation web certifiantes en direct avec 50 formateurs internationaux
- Formation systémique généraliste
- DU clinique de la relation avec l‘université de Paris 8
- Mastere clinique avec spécialisation en psychopathologie avec le CTS du Pr Nardone




